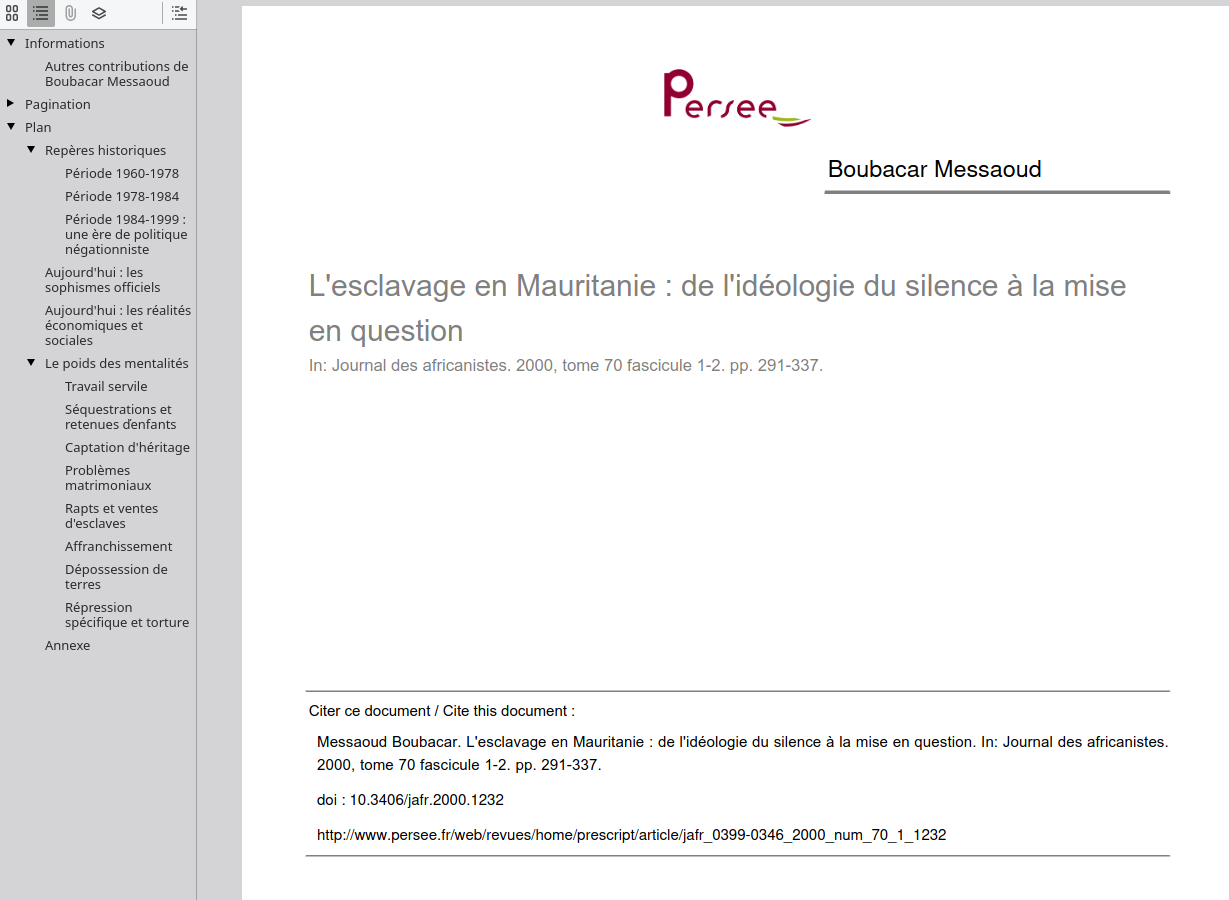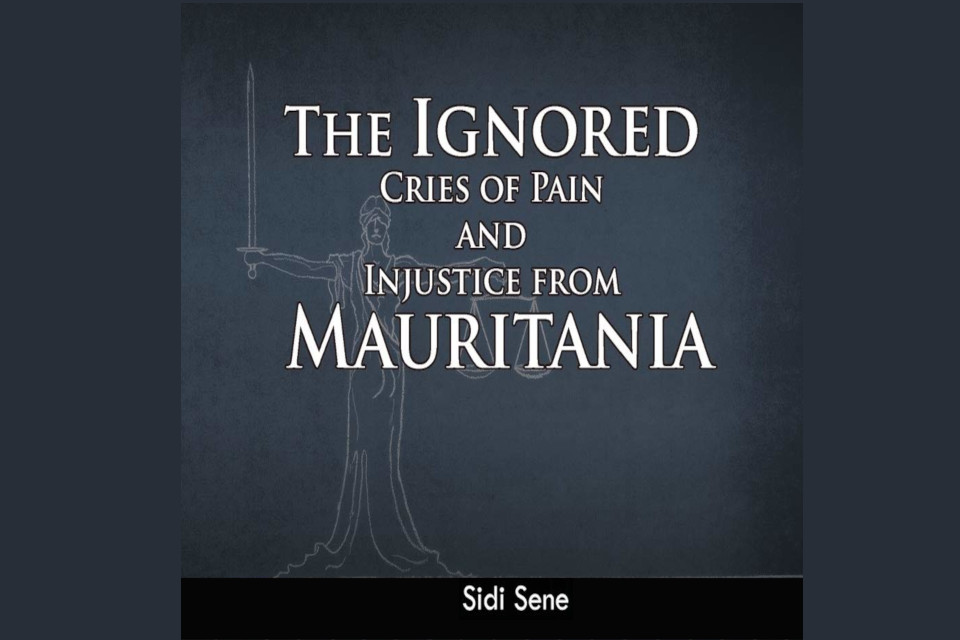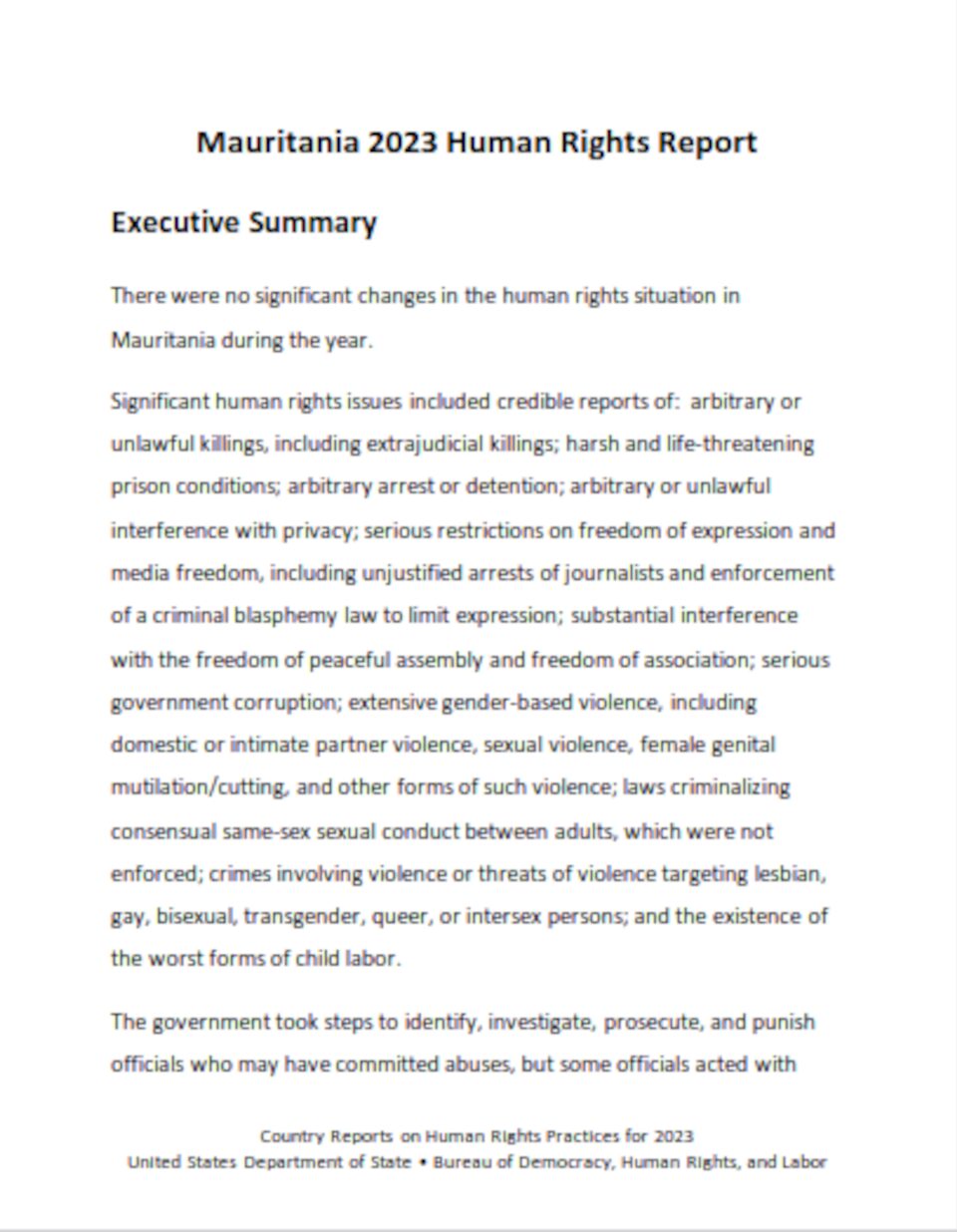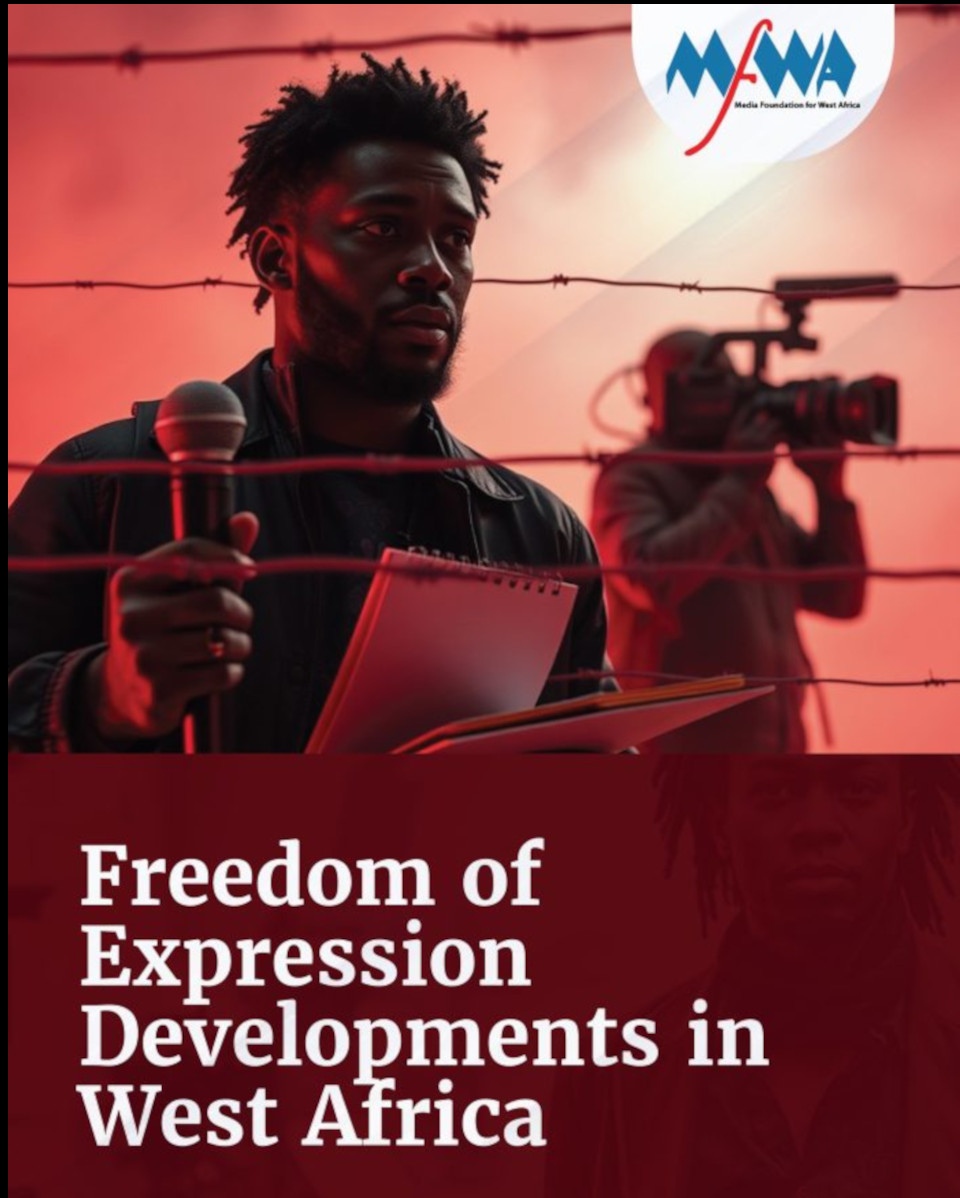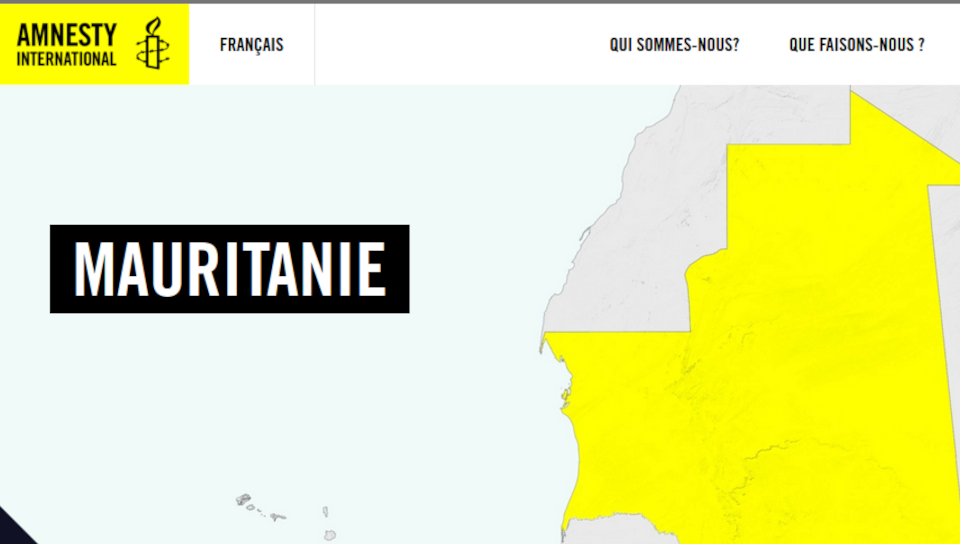Cet article repose sur la collecte d’informations par tous les militants de SOS-esclaves : qu’ils en soient tous remerciés ici.
En 2000, l’esclavage reste en Mauritanie un sujet tabou. Ni les autorités traditionnelles, ni les pouvoirs publics ne veulent être mis en cause à ce propos et montrés du doigt. Aussi, afin d’éviter l’accusation de complais ance,voire de complicité, les uns et les autres s’efforcent-ils d’étouffer toute velléité de poser le problème publiquement et d’en débattre. Paradoxalement, taire la question servile dans notre pays tiendrait lieu de solution. Or, c’est précisément cette politique du silence qui favorise la pérennité du phénomène. Toutes les tentatives pour lever le voile sur ces honteuses pratiques sont invariablement assimilées aux élucubrations d’individus en mal de promotion et animés de sentiments revanchards. Tel est le terrorisme politique qui vise à perpétuer l’idéologie du silence et le statu quo social de la domination et de l’asservissement.
Les chercheurs mauritaniens en sciences sociales ont, pour l’essentiel, occulté cette question, alors que son anachronisme même aurait dû justifier sa présence parmi les grands thèmes de la recherche sociale. À ces facteurs s’ajoute le fait de la relative prospérité économique d’une infime proportion d’anciens esclaves, dont la réussite est souvent présentée comme la preuve que ceux qui mettent l’accent sur la question de l’esclavage conjuguent au passé.
Les chancelleries, notamment occidentales, du fait même qu’elles ne voient que la vitrine à usage externe du pays et de sa société, sont générale menttrès sensibles à ces arguments fallacieux. En raison de leur incapacité à saisir les ressorts sociaux qui sous-tendent la pratique de l’esclavage, ainsi que les mécanismes par lesquels celui-ci s’exerce en dehors de l’espace légal. elles ont tendance à le considérer comme la manifestation marginale de séquences historiques dépassées et de moins en moins fréquentes. Or, les cas mis au jour épisodiquement cachent en vérité une pratique diffuse, massive et permanente.
C’est ainsi que depuis l’adoption de l’ordonnance du 9 novembre 1981 portant abolition de l’esclavage, aucun décret d’application de cette loi n’a encore été pris, d’où son caractère de simple alibi résultant des pressions nationales et étrangères. Mieux, la Mauritanie a toujours entretenu une
grande confusion sur la compétence des différentes juridictions — tribunal du premier degré et tribunaux des cadis de droit musulman — en matière de contentieux touchant l’esclavage. Cela explique pourquoi la jurisprudence en matière de répression de l’esclavage est inexistante, en dépit de l’impor tancedes cas flagrants continuellement soumis à l’autorité. En réalité, dans le droit pénal mauritanien, aucune disposition spécifique ne reconnaît ni ne punit les faits d’esclavage. Du coup, l’ordonnance de novembre 1981 demeure un texte inopérant et sans portée réelle, plus destiné à l’opinion étrangère qu’à combattre chez nous une pratique d’un autre âge.
Si la colonisation a eu parfois à l’égard de l’esclavage une attitude hésitante et contradictoire, elle considérait avant tout sa suppression brutale comme socialement impossible, voire dangereuse. Elle ne pouvait sévir contre cette institution sans désorganiser le système de production traditionnel, sans s’attaquer aux couches dominantes sur lesquelles elle s’appuyait, sans saper leur autorité et, par conséquent, celle de l’autorité coloniale elle-même.
Aujourd’hui, depuis l’indépendance, le même froid calcul fonde les mêmes fébriles tentatives pour maquiller l’asservissement d’êtres humains